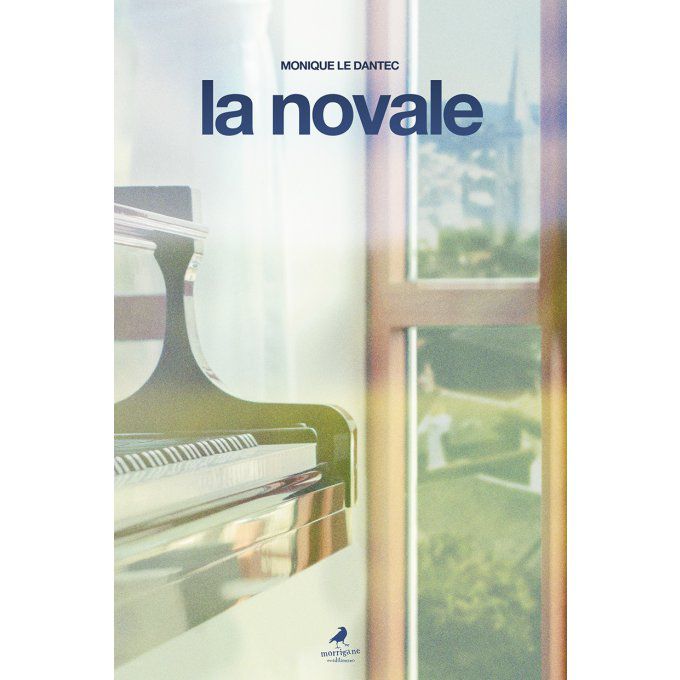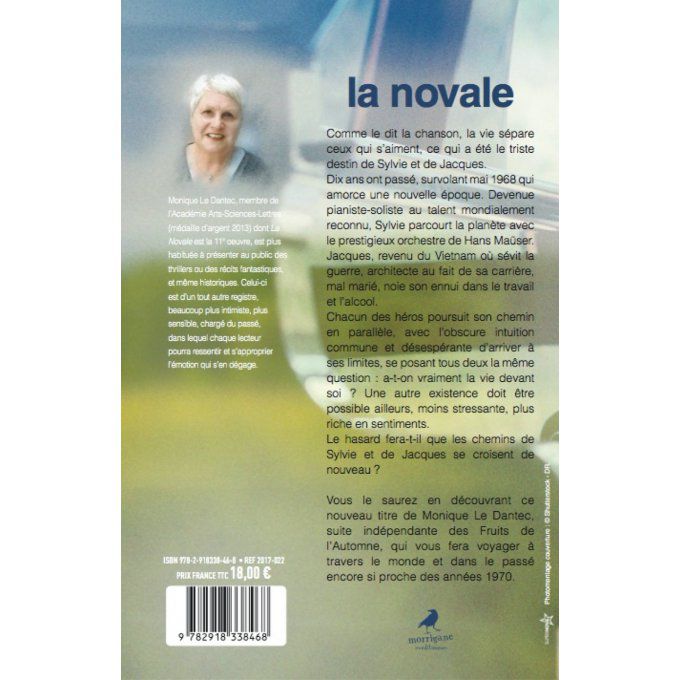LA NOVALE - Monique LE DANTEC
PREMIÈRES PAGES
1 — NEW YORK
Rectiligne jusqu’au vertige, somptueuse jusqu’à l’angoisse, gigantesque jusqu’à la folie, New York palpite et gronde. Dans la nuit glaciale où le vent d’hiver rugit comme un fauve en- chaîné, les gratte-ciel s’élancent, se superposent, se fondent dans l’air tourbillonnant. La pluie, durcie par les brusques rafales qui s’abattent depuis ce matin sur la ville, masque les immeubles du Lincoln Center et ruisselle contre les vitres.
Ce complexe culturel abrite cinq salles de concert, une bi- bliothèque et divers emplacements de spectacle, répartis au- tour d’une esplanade bordée des hautes tours de Broadway en toile de fond.
Difficile d’imaginer que ce lieu contemporain a remplacé tout un quartier insalubre, celui qui avait servi de cadre au film West Side Story. Ma mère avait adoré cette reprise mo- derne de Roméo et Juliette, que nous avions vue à plusieurs reprises. Elle aimait ces chansons qu’elle savait par coeur. Les murs de notre appartement du quai des Célestins résonnent encore de ses vocalises, même si elle chantait aussi faux que possible ! Je souris à cette évocation.
Elle connaissait New York, pour y être venue avec mon père dans les années 1930. Peut-être même est-elle passée à cet en- droit précis ? En tout cas, je me rappelle, même si je n’avais pas prêté une attention particulière à ses propos à ce moment,
11
qu’elle avait été subjuguée par cette métropole.
Ceci expliquant d’ailleurs sans doute cela, son amour pour ce film musical ? Ou bien est-ce simplement un souvenir de voyage à une époque où les gens bougeaient peu, que les dé- placements aussi lointains n’étaient réservés qu’à une élite ? Ce qui était le cas de mon père, Camille Legrand, violoniste réputé dans le monde entier, décédé à la guerre l’année de ma
naissance.
En tout cas, le succès que ce film a connu en France, où il est
resté à l’affiche du cinéma Georges V pendant presque cinq années, prouve que ce type de musique a bien été une ouver- ture sur une ère nouvelle.
Après cette petite incursion dans le passé, je reviens à mon observation, me demandant à quel moment le taxi doit venir nous chercher.
La plaza centrale, devant lequel l’Opéra aux arcades harmo- nieuses se situe, rutile comme un miroir sous les lampadaires. C’est là où sont présentés les spectacles du Metropolitan Ope- ra et de l’American Ballet. Sur la droite, on voit l’Avery Fischer Hall abritant le New York Philarmonic qui travaillait avant avec le Carnegie Hall, où nous nous sommes également pro- duits la semaine dernière.
En face, à travers le souffle saccageur des bourrasques inces- santes, je distingue à peine le New York State Theater où sont domiciliés les New York City Opera et City Ballet. C’est tout un monde de compositeurs, d’artistes, de musiciens, de chan- teurs, de danseurs, ainsi que tous les directeurs d’orchestre et les techniciens qui permettent aux précédents d’exercer leurs talents, qui s’agite dans ce haut lieu de la culture comme dans une ruche.
Le front collé à la vitre, je tente en vain de déceler entre les immeubles les arbres dénudés de Central Park. Je les devine se tordant sous le vent fou et rageur.
12
Mais les buildings de Manhattan, insensibles aux éléments furieux, vibrent de leurs feux artificiels, imperturbablement.
Cette ville cosmopolite, que je regarde sans vraiment voir, dont j’essaie de percer l’âme sans pour l’instant y parvenir, tout à tour me fascine et m’envoûte, m’horrifie et m’irrite.
Il est évident qu’en France, nous avons commencé à nous calquer sur la culture américaine. J’en ai pris conscience en entendant les sirènes des voitures de police, des pompiers et des ambulances fréquentes dans les films américains, désor- mais familières à nos oreilles.
Toutefois, la démesure des cités que nous avons traversées ces dernières semaines est toujours un étonnement pour moi, même si, à l’occasion des concerts de Hans Maüser où je suis pianiste, j’ai eu l’occasion de visiter la plupart des capitales ou de grandes villes de l’Occident. Rome, Venise, Londres, Prague, Budapest, Barcelone, la plupart n’ont plus de secrets pour moi... Chacune a ses spécificités, mais elles n’ont rien de commun avec celles des États-Unis.
Mais, d’entre toutes, New York est pour l’instant celle qui m’interpelle le plus. Le vide sous une apparence de multitude ? Ou une réelle emprise de société ? Le froid de la solitude der- rière une effervescence fébrile ? Ou juste une impression fugi- tive due à ce temps désastreux que nous avons depuis quelques jours ? J’ose croire que les hommes se côtoient sans s’ignorer, se parlent d’une seule voix et entendent les mêmes sons tandis qu’ils fourmillent comme des insectes clairvoyants. Métropole déroutante où je devine la beauté se confondre avec la laideur, la richesse avec la misère. Caravansérail contemporain, reflet d’une civilisation que je souhaite ne pas être sur son déclin.
Nous attaquons cette année 1973 par des pluies diluviennes qui ne nous ont pas permis de visiter la ville à fond comme nous l’espérions. Des traces encore fraîches des fêtes de Noël
13
et du Nouvel An persistent à tous les coins de rue, avec ses de- vantures scintillantes et ses sapins décorés au milieu des lueurs palpitantes des buildings.
Si ma première impression est perturbante, je suis certaine qu’au-delà de ces premières apparences, elle s’inscrira dans les lieux qui marqueront mon esprit. Je prie donc le Dieu Météo de bien vouloir calmer sa fureur et nous laisser profiter de cette ville si déroutante.
M’éloignant de la vitre ruisselante, je vais m’installer dans un fauteuil du hall et commence à compulser les brochures touristiques qui traînent dans mon sac à main, en attendant l’arrivée de mon assistant.
L’entrée bruyante de Karl-Heinz, plus rapide que je le pré- voyais, me fait sursauter.
— Mademoiselle, avez-vous fini de classer les partitions ? Désirez-vous mon aide ?
À regret, je range les papiers et me tourne vers mon interlo- cuteur, remettant à plus tard ma lecture :
— Je vous remercie, Karl-Heinz. Mes affaires sont prêtes. Vous pouvez appeler un taxi.
J’ai donné ce soir mon dernier récital dans cette ville. Outre ma participation dans l’orchestre, je me produis désormais en tant en soliste, au gré de mon humeur et des invitations auxquelles je ne me soustrais jamais. Sylvie Legrand, virtuose française, me qualifie-t-on maintenant. J’avoue ne pas en avoir conscience, j’ai toujours l’impression que les autres pianistes jouent bien mieux que moi.
Après une tournée de quelques semaines à travers les États- Unis, durant laquelle nous avons sauté de car en avion et de train en taxi, avec pour seuls intermèdes quelques heures d’en- traînement par jour, nous rentrons bientôt en Europe.
Mon piano électrique, un Wurlitzer 64 touches, me suit dans 14
tous les hôtels, transporté dans une camionnette louée spécia- lement à cet effet et par bateau pour ce voyage-ci. On doit un fier service à Ray Charles qui a considérablement mis au goût du jour ce genre d’instrument. Un peu différent du Rhodes que Hans m’avait prêté à mon arrivée, celui-ci comprend un haut-parleur intégré ainsi qu’un trémolo que l’autre ne possé- dait pas. Plus rien à voir avec celui d’étude sur lequel j’ai fait mes premières gammes, le Gaveau, qui se trouve toujours dans l’appartement du quai des Célestins, relégué dans ma chambre maintenant depuis l’arrivée d’un autre instrument bien plus prestigieux ! J’ai en effet pu réaliser mon rêve d’acheter un quart de queue, une véritable merveille.
Ce voyage qui nous a fait passer de Los Angelès à San Fran- cisco, d’Albuquerque à Memphis et de Washington à New York avec un détour par Boston me laisse une impression ef- frénée de course contre la montre. Il reste dans mon esprit un kaléidoscope de couleurs, d’odeurs et de sensations nouvelles, éphémères.
N’ayant pas eu l’occasion, faute de temps, de visiter toutes ces villes, je me suis fait la promesse d’y revenir un jour. Mais pour celle où nous séjournons en ce moment, j’ai la ferme intention d’y consacrer les jours suivants, ce qui était d’ailleurs prévu avant la tournée.
Hans, appelé à d’autres concerts à Vienne est reparti avec tout l’orchestre.
Je reste donc seule avec Karl-Heinz le régisseur — exception- nellement, Hans a accepté de se passer de lui quelques jours — qui s’occupe de l’organisation des transferts et des contacts avec nos hôtes, ainsi que Noémie, une jeune Alsacienne qui terminait des études de chant à Vienne. Elle a préféré se lan- cer dans l’aventure avec moi, aucune vocation ne s’étant vrai- ment révélée au cours de ses deux années d’apprentissage, sauf à lui abîmer ses cordes vocales. D’où son rire un peu rauque
15
et une parole légèrement saccadée. C’était avec tristesse qu’elle s’apprêtait à retourner à Colmar quand nous nous sommes rencontrées. Mon offre de l’embaucher comme assistante et surtout la perspective de voyager avec moi lui a plu et nous nous sommes mises d’accord très vite.
Par contre, je n’ai pu me résoudre à la loger dans mon ap- partement, même si la place était suffisante. J’aime trop mon indépendance et ma liberté pour avoir quelqu’un à demeure, aussi sympathique et indispensable soit-elle. Elle s’occupe du ménage, du linge et de la cuisine, mais surtout m’aide à me procurer ce qui m’est nécessaire pour les récitals et note les rendez-vous. Rôle d’interface entre mes vies professionnelle et privée, qu’elle a pris avec sérieux.
Je ne saurais me soustraire à sa bonne humeur et son rire ravageur. Petite, un peu rondelette, blonde aux cheveux bou- clés et aux yeux noisette, elle possède une capacité de la dé- dramatisation bien utile quand le stress des avant-premières commence à me mettre sur les nerfs.
En fait, elle est tout le contraire de Karl-Heinz, d’une rigu- eur toute germanique et d’un sens de l’humour totalement absent. Je me félicite de l’avoir embauchée à mon arrivée à Vienne. Elle représente aussi le lien entre ma vie d’avant et la nouvelle. J’avais besoin de quelqu’un qui parle parfaitement l’allemand, et qui ait suffisamment de connaissances au niveau de la musique.
Ayant quitté la France au décès de ma mère avec l’intention de ne pas y revenir, ou alors bien plus tard, quand les cicatrices du passé seront refermées, je me suis installée en Autriche dans la précipitation et une sorte d’état second.
Même si Hans Maüser m’avait facilité la tâche en me trou- vant un appartement en centre-ville, juste à côté de la Hof- burg, j’avoue avoir été déboussolée les premiers temps, peut- être plus par manque d’énergie que de véritable dépaysement.
16
J’ai rencontré Noémie quelques jours après mon arrivée, faisant un tour au Prater, l’âme en berne et le pied traînant. Ayant pris place sur un banc à regarder les pigeons sans les voir, j’ai dû me mettre à pleurer sans y prendre garde. Elle était assise à côté de moi, et m’a tendu un mouchoir. Elle a parlé, m’a réconfortée, et de fil en aiguille, nous avons sympathisé.
Elle intégrait son poste actuel les jours suivants. Si ses compé- tences à servir, comme les miennes à avoir recours à quelqu’un, laissent parfois à désirer et provoquent de temps en temps des catastrophes et des fous rires de part et d’autre, elle m’est abso- lument indispensable.
Soudain, j’aperçois Karl-Heinz en train de discuter avec quelques membres du Philarmonic Hall et du Métropolitain Opéra, ainsi que des reporters de la presse et de la télévision venus nous adresser leurs adieux. Il me fait un signe discret de les rejoindre.
Restée réfractaire à tout apprentissage des langues vivantes à l’exception de l’allemand par évidente nécessité, Karl-Heinz traduit au fur et à mesure à mon intention. J’admire sa capa- cité à discourir couramment dans la plupart des pays que nous traversons.
Il semble que l’on nous voit partir à regret. J’en suis aussi surprise qu’heureuse, car je ne m’attendais pas, ni pour Hans Maüser ni pour moi-même, à un tel succès. Une sorte de déri- vatif pour les New Yorkais, sans doute. Il faut dire que les États-Unis pataugent depuis l’été dernier en plein scandale du Watergate. L’affaire a été déclenchée par un cambriolage dans les locaux du parti démocrate à Washington. Seules les accusations de la presse d’investigation du Washington Post et les explications pour le moins vaseuses de Richard Nixon me semblaient retenir l’attention des Américains. J’avoue m’y être assez peu intéressée, mais la persistance des médias sur le sujet
17
ne peut m’échapper non plus. Il n’est donc pas un jour que l’on voit le visage du chef d’État sur les écrans de télévision. Je ne comprends pas grand-chose à leurs interprétations. Mais j’achète les journaux de la presse française, et, bon gré mal gré, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde. Car même la France s’y intéresse beaucoup, à ce Watergate !
Aux dires des médias, en pleines investigations, supputations, commentaires, analyses, conclusions... il apparaîtrait que ce cambriolage a été commandité par la Maison-Blanche et qu’il y aurait un problème de financement illicite de la campagne présidentielle.
Ce qui n’a d’ailleurs pas empêché la réélection de Richard Nixon en novembre dernier. L’enquête du FBI semble a priori assez sommaire. Mais ce scandale me paraît très loin d’être terminé et il faut s’attendre à des rebondissements dont nous aurons des échos, sans nul doute, à travers le monde.
Angie C.Keller, le boss du Philarmonic Hall qui vient de rallier le groupe, me fait revenir à l’instant présent, en insis- tant vivement pour que nous le suivions à son domicile, son épouse donnant ce soir un cocktail en notre honneur.
Je refuse, prétextant une migraine, mais invite Karl-Heinz à se joindre à eux, qui accepte sans broncher, en proposant tou- tefois d’un ton qui est plus une affirmation qu’une question :
— Voulez-vous que je vous accompagne à l’hôtel ?
Le hall est rempli de gerbes de fleurs, offertes par des mélo- manes enthousiastes. Il se charge manu militari de les faire transporter au Wales Hôtel sur Madison Avenue où nous sommes descendus à la suite du départ de Hans. Je souhaitais un lieu un peu moins luxueux que celui où nous étions avant, au Waldorf Astoria. Noémie, qui doit s’y trouver maintenant, avait remarqué cet hôtel confortable de l’autre côté de Central Park. Le temps serait plus clément, j’aurais préféré y aller à
18
pied, mais la pluie semble redoubler d’intensité, et j’accepte sa proposition.
Les mains se serrent encore, les « au revoir » s’éternisent. Je suis lasse.
Karl-Heinz, efficace comme toujours, coupe court aux congratulations, avec autant de politesse que de fermeté. Nous quittons enfin le Lincoln Center. Un checker nous attend, grosse berline dans laquelle on amoncelle les gerbes de fleurs les unes sur les autres. Nous prenons place dans l’espace réduit qui reste, sur les strapontins.
Cachés par le toit de la voiture, les buildings qui ont disparu de notre vue pendant l’instant du trajet ressurgissent de part en part. Mais je les devine plus que je ne les aperçois, leurs sommets se perdent dans le néant de brume noire qu’affiche le ciel ce soir.
Mon compagnon, suivi du chauffeur de taxi et d’un portier, les bras chargés des gerbes, me conduit jusqu’à la chambre, puis, après un bref salut de la tête, file rejoindre nos relations new-yorkaises qui l’attendent au Philarmonic Hall. Il doit être content, car je l’entends siffloter dans le couloir avant de refermer la porte. Les fleurs embaument la pièce de leurs fra- grances capiteuses et alourdissent l’atmosphère. Je n’ai qu’une hâte, m’assoupir. Noémie a dû regagner la sienne et je ne vais pas la déranger. J’accroche le panneau « Do not disturb 1 ». Mais la fatigue qu’un bain chaud ne dissipe pas et l’excitation du prochain départ pour l’Europe m’empêchent de trouver le sommeil.
Seul quartier de New York que je connaisse un peu, Man- hattan m’oppresse. À moins que ce ne soit que ce mauvais temps qui persiste depuis notre arrivée. Ce matin, Karl-Heinz m’a entrainée tambour battant au sommet de l’Empire State Building. La vue s’y étend à l’infini, malgré les nuages qui
1 « Ne pas déranger ».
19
s’amoncelaient furieusement à l’est. J’ai tenté de déceler les tours principales, le Top of the Rock où nous devons égale- ment nous rendre, immortalisé par la fameuse photographie des ouvriers assis sur une poutre en train de prendre leur dé- jeuner en plein ciel, la Chrysler Tower si particulière avec sa pointe d’écailles, les tours de l’ONU voisines, et surtout les Twins du World Trade Center qui seront les plus hautes du monde. Elles doivent ouvrir au public au printemps prochain. Je désire absolument voir le chantier en construction. Ce doit être pharaonique.
Ensuite, nous en profiterons pour découvrir, toujours dans le nord de Manhattan, les Cloisters sur l’Hudson River à côté de fort Tyron. Ces monastères rapportés pierre par pierre pro- viennent en particulier du sud de la France. Je suis assez cu- rieuse de savoir comment nos amis américains les ont recons- titués, même si l’idée de cette acquisition me fait quelque peu grincer des dents.
Ma mère, scandalisée sur le sujet, m’en a parlé à maintes reprises, quand l’envie lui prenait de me raconter les voyages effectués avec mon père avant ma naissance et the Cloisters avaient marqué son souvenir. Elle me disait alors que le sculp- teur George Barnard avait rassemblé une quantité impression- nante de vestiges architecturaux du Languedoc-Roussillon. Elle précisait qu’en 1925, John D.Rockeffeler avait fait don d’une somme très importante au Metropolitan Museum pour acquérir la collection, qu’il enrichit ensuite avec des oeuvres lui appartenant.
Ce qui me fait penser soudain à cette manie de Karl-Heinz, siffloter les jours de grande forme — ce qui est si rare qu’il est bon de le noter — les neuf notes de la gamme ! J’ai lu leur « invention » dans un monastère du sud de la France, dont j’ai hélas oublié le nom. Cette origine m’avait frappée, et je ne l’ai jamais oubliée.
20
UT, RE, MI, FA, SOL, LA, SI... toute une histoire ! Dans notre civilisation latine, ces notes proviennent de Guido d’Arezzo dans L’Hyme pour Saint Jean-Baptiste, bien connu des moines.
UTqueant laxis — Pour que puissent REsonare fibris — résonner des cordes
MIra gestrorum — détendues de nos lèvres FAmili tuorum, — les merveilles de tes actions, SOLve polluti — ôte le péché,
LAbii reatum, — de ton impur serviteur, Sancte Johannes — Saint Jean
On retrouve donc avec les premières syllabes de chaque phrase, le nom des notes en usage dans les pays latins, à deux détails près. Le SJ est devenu le SI par Anselme de Flandres, au 16e siècle. Puis le DO est apparu au siècle suivant en rem- placement du UT que les Italiens trouvaient trop difficile à chanter.
Par contre, nos amis germaniques ont eu quelques nuances, aimant composer à partir des mots. Bach a ainsi créé son Art de la Fugue à partir des lettres de son propre nom, ainsi que Schumann qui aimait aussi faire jouer le langage et les sons.
Mais qu’on appelle les notes par ces noms ou par des lettres de A à G comme on le voit dans les pianos à côté des chevilles pour faciliter le travail des accordeurs, il n’en reste pas moins que la musique, peu importe de la façon dont on l’écrit, est universelle.
Au Japon, du LA au SOL, les sept notes de la gamme ja- ponaise sont associées aux premiers catactères de l’iroha, un classement utilisé pour l’apprentissage de la calligraphie. En Inde, les swaras sont également au nombre de sept, chacune des notes renvoyant au bruit naturel d’un animal, le cri du paon, le beuglement de la vache, le bêlement de la chèvre, le
21
cri du héron, le chant du rossignol, le hennissement du cheval et de l’éléphant qui barrit.
Mais pour en revenir à Karl-Heinz, les yeux bleus cerclés de fines montures d’acier, la trentaine, froid, un peu hautain, il exerce sur moi une sorte de fascination aux limites de l’an- goisse. J’ignore tout de lui, si ce n’est qu’il agit aveuglément aux ordres de Hans Maüser. Je ne pense pas qu’il ait une fa- mille proche, encore moins une épouse et des enfants. Mais j’avoue n’être sûre de rien. Je ne connais même pas son adresse à Vienne. C’est dire ! C’est toujours lui qui me contacte quand il a quelque chose de précis à me faire savoir, le plus souvent une consigne de Hans.
En revanche, j’ai remarqué à plusieurs reprises qu’il possède une grande culture, concernant la musique bien sûr, mais éga- lement en littérature, en peinture, enfin pour tous les arts en général. Je lui ai dit une fois, répondant à une question parti- culière que je me posais sur un détail architectural, qu’il était une véritable encyclopédie vivante. C’est une des rares fois que je l’ai vu sourire. Par contre, il est évident qu’il voue une admi- ration sans borne envers Hans.
Hans. Mes pensées m’emportent à nouveau vers lui et vers l’Autriche, en attendant le sommeil. Allongée sur le lit, dans une chambre confortable et douillette, je perçois une cacophonie diffuse sur Madison Avenue qui m’enveloppe et m’empêche de dormir. Dans un regain d’énergie, il me prend soudain, probablement aussi à cause d’une agitation que je devine à travers les cloisons, l’envie de sortir, de me mêler à la foule. D’autant que la pluie vient enfin de cesser, et que les nuages semblent s’enfuir vers l’ouest à grande vitesse, décou- vrant quelques morceaux de ciel étoilé. Noémie, que je croyais invisible jusqu’au lendemain, passe s’enquérir de mes souhaits. Je lui demande si elle désire m’accompagner. Contrairement à
22
son habitude, toujours enthousiaste, un regard horrifié, New York, la nuit de surcroît, un oh ! plaintif et ravalé de justesse, une hésitation crispée, elle voudrait pourtant m’être agréable, et un Oui, Mademoiselle, avec plaisir, timide et incertain, me répondent. Je fais celle qui ne remarque pas son désarroi, tout à fait exceptionnel, et la remercie chaleureusement.
— Nous ne prendrons pas le métro, n’est-ce pas ?
Je la rassure en souriant. N’empêche... je l’aurais bien testé ! Mais nous verrons cela demain. Je ne vais tout de même pas la contrarier pour si peu, et je demande à la réception qu’on nous appelle un taxi.
L’employé à qui nous avons confié notre désir de balade noc- turne nous dissuade vivement de nous rendre à Harlem où le danger de se promener la nuit est réel, pas plus que Times Square qui semble jouir également d’une mauvaise réputation.
Nous lui promettons de suivre ses conseils et je prie le chauf- feur, à grand renfort de gestes sur le plan, de nous conduire vers Chinatown où je voudrais trouver un restaurant. Celui- ci, protégé des voyageurs par une vitre blindée, nous propose dans un premier temps de faire le tour de Manhattan, ce que traduit Noémie, car je n’avais pas compris grand-chose à son offre. Celle-ci, à l’abri dans la grosse voiture jaune, est ravie. J’accepte pour lui faire plaisir.
Nous quittons le Wales Hôtel. Après avoir longé Central Park, remarquant au passage les formes rondes du Guggen- heim Museum, nous continuons sur Park Avenue, dépassons la cathédrale Saint Patrick puis le Grand Central Terminal, admirons à nouveau l’Empire State Building.
Puis l’homme nous fait repasser par Times Square, incon- tournable la nuit, qui fourmille et grouille d’autant de pié- tons que et de panneaux lumineux, véritable symphonie au coeur des gratte-ciel qui se dressent autour comme des épées
23
de glace, sinon de justice. Je me promets d’y revenir au jour. J’avoue ne pas y déceler de grands dangers !
Les zigzags et les discours entrecoupés de larges éclats de rire du taximan s’arrêtent subitement à la vue d’une voiture de police qui stationne à l’angle de la 42e Street et c’est plus cal- mement qu’il reprend le chemin. Nous voici dans la 5e Ave- nue, le quartier résidentiel. Je demande qu’il nous dépose là. Mon charabia franglais en est-il la cause, ou bien le chauffeur n’a-t-il pas entendu, ma requête reste sans réponse ni effet. C’est avec un virage à gauche qui fait hurler les pneumatiques qu’il pique maintenant vers Soho. Ce qui est surprenant, car il m’a semblé que les conducteurs étaient très disciplinés ici, roulant à vitesse tout à fait raisonnable, s’arrêtant à tous les feux rouges, et pointant du doigt ceux qui ne respectaient pas les passages piétons, dont, en bonne Parisienne que je suis, je fais partie.
Contournant le quartier des Twins en fin de construction, mais pas encore éclairées, ce qui fait un trou noir dans les tours, nous nous dirigeons vers Wall Street, et arrivons enfin à Chinatown. Le chauffeur, investi de sa mission de guide new- yorkais, laisse entendre qu’il se joindrait volontiers à nous au restaurant. Je crois comprendre que sa journée, sa nuit devrais- je dire, est finie. La présence d’un homme du pays à nos côtés me convient parfaitement, et j’accepte avec plaisir. Il stoppe le taxi devant l’un des immenses parkings souterrains, éteint les feux, et nous convie à le suivre, après avoir confié les clés de la voiture au gardien qui se charge de la garer.
Malgré le froid ambiant — heureusement, Noémie et moi sommes chaudement couvertes —, une foule intense et bigar- rée hante les rues de Chinatown. Une multitude de restau- rants aux devantures surmontées de lampions en papier rouge et de pendeloques dorées s’activent et offrent aux passants
24
leurs mets exotiques. Notre menu est copieusement arrosé de saké dont notre ami profite largement entre deux éclats de rire tonitruants.
Harlem revenant sans cesse dans la conversation de notre in- terlocuteur, je crois comprendre qu’il est originaire de ce quar- tier. Ses gestes semblent vouloir nous dire que nous devons nous y rendre absolument avec notre départ pour connaître réellement Big Apple.
Jerry, la parole abondante et le regard embué, insiste pour que nous l’appelions par son prénom, because we are friend, now, aren’t we 2 ? nous propose de nous y conduire demain. Ce que je refuse gentiment, lui expliquant que nous y sommes déjà allés ce matin, et que nous avons même assisté à une messe gospel, ce qui le ravit, car il éclate d’un rire tonitruant. En effet, à la demande de Noémie qui a eu une excellente idée, nous avons commencé la journée par un office à Harlem puisque nous étions dimanche et que mon récital cet après- midi ne commençait qu’à quinze heures.
Nous nous sommes donc retrouvés avec Karl-Heinz devant une première église où se situait une queue impressionnante, mais nous avons été refoulés du fait de notre tenue trop dé- contractée. Je n’aurais pas pensé que les blue-jeans et des ano- raks puissent traumatiser les Américains à ce point ! Quoi qu’il en soit, ce n’était pas bien méchant et l’on nous a redirigés vers la Mt. Calvary Baptist Church, un pâté de maisons plus loin, qui accepte les touristes avec un habillement plus sommaire.
Il est vrai que nous avons été surpris par l’élégance, prin- cipalement des dames, les hommes étant tous en pardessus, toutes superbement habillées de manteaux de beaux lainages ou de fourrure et grands chapeaux à froufrous ! Mais le spec- tacle valait le déplacement. Après une homélie enthousiaste du pasteur à laquelle je n’ai rien compris, d’autant qu’il avait
2 parce que nous sommes amis, maintenant, n’est-ce pas?
25
une voix de basse magnifique, mais qui n’arrangeait guère les choses, les chants ont commencé, et quelques minutes plus tard, tout le monde dansait dans l’assemblée. Et là, il ne s’agis- sait pas d’artistes, mais de citoyens noirs lambda. J’en garderai longtemps un bon souvenir, car nous avons été accueillis avec chaleur et amitié. De quoi renouer avec la religion !
Quand nous sortons du restaurant, si la tempête a totale- ment cessé, une petite bruine fine et grise tombe sur la ville, froide et pénétrante. Jerry s’absente un instant pour récupérer la Cadillac dont les larges pinceaux lumineux se reflètent sur la chaussée luisante. Notre retour s’effectue à vive allure, notre chauffeur n’ayant plus aucun respect pour les panneaux de cir- culation.
Au lit après une douche rapide, je m’endors cette fois brus- quement d’un sommeil habité d’un songe merveilleux, où New York, cité d’or et de cristal, fabuleuse et fantastique, brille d’un éclat incandescent, à la limite du soutenable.
Très tôt dans la matinée, le cliquetis de la machine à écrire, dans la chambre voisine, me réveille peu à peu. Puis la sonne- rie du téléphone efface les derniers lambeaux de rêves qui en- gourdissaient encore mon esprit. C’est la réception de l’hôtel qui m’avertit qu’on m’attend dans le hall. Notre guide de la nuit est en avance, pressé sans doute de nous faire découvrir son univers.
Loin d’être prête, je le prie de bien vouloir patienter un mo- ment, puis, m’enveloppant d’un peignoir, je passe à côté.
Karl-Heinz, dispos comme toujours, a déjà dactylographié une partie du courrier et donné un nombre impressionnant de coups de fil. Je lui demande s’il a toujours l’intention de venir avec moi pour cette balade à Brooklyn. L’écouteur télé- phonique collé à l’oreille, il acquiesce d’un mouvement du menton.
26
Tandis que je me prépare, sa voix brève et péremptoire tra- verse la cloison. J’ignore qui est son interlocuteur invisible. Je sais simplement qu’il ne s’agit pas de Hans Maüser. Avec lui son ton change, se fait doux et humble, il perd cette indiffé- rence glaciale qui le caractérise la plupart du temps. Puis il se remet à taper, la sonnette de fin de ligne résonne comme un métronome.
Karl-Heinz. Impossible de l’imaginer sans téléphone ni ma- chine à écrire. La sienne le suit partout, une Triomph Tippa, de fabrication hollandaise, impeccable dans sa valise gris acier. Il prévoit, organise, exécute, toujours maître en son domaine.
Pour ma part, je me contente de jouer au piano. Où, quand, devant qui, peu importe. C’est mon entourage qui décide. Avec ce désintérêt de l’avenir qui s’est ancré dans mon esprit, je ne désire rien d’autre. Alors, grâce à la musique, s’efface cette double souffrance mal oubliée que je porte en moi, le départ de Jacques et le décès de ma mère.
Nous descendons rejoindre enfin notre nouvel ami, Jerry, qui trompe son impatience en mastiquant vigoureusement son chewing-gum. Un sourire éclatant fleurissant sur les lèvres, le jean douteux et le cheveu indiscipliné dépassant de sa cas- quette de joueur de base-ball, notre homme nous entraîne vers sa Cadillac jaune.
Jerry scrute le ciel, la mine dubitative. On dirait qu’il va nei- ger. Je crois comprendre que les New Yorkais la craignent. Je me souviens, pour en avoir vu les effets aux actualités télévi- sées, des hivers redoutables qui paralysent cette ville régulière- ment. Blocs de glace charriés par l’Hudson, neige abondante qui stoppe l’hyperactivité de la cité. Mais nous n’en sommes pas encore là.
New York endormie. Difficile à imaginer pour le moment. L’encombrement est tel dans les rues que nous roulons au pas.
27
Un tramway aérien, que Jerry nous désigne comme étant la High Liner, passe au-dessus de nous dans un fracas étourdis- sant et nous fait sursauter.
Notre chauffeur, la parole féconde et tonitruante, converse avec Karl-Heinz qui lui répond sur un rythme qu’il m’est im- possible de suivre. Je me contente d’observer ses mains avec inquiétude. La droite scande, à grands mouvements, ses éclats de rire, tandis que la gauche tient nonchalamment le volant. Et je guette l’instant où elle ne remplira plus son office.
Après avoir zigzagué dans un dédale d’avenues et de rues toutes perpendiculaires, arrivons au pont de Brooklyn. Ayant l’intention de le traverser à pied, nous donnons rendez-vous à Jerry de l’autre côté. Il nous précise exactement où sur le plan, et nous convenons de l’heure.
Sur un fond de ciel gris laiteux, ce célèbre pont suspendu qui relie Manhattan à Brooklyn est magnifique. Jetant un coup d’oeil à ma documentation, je vois qu’il a été édifié au 19e siècle, et inauguré en 1883. Avant sa construction, cinquante millions de personnes environ prenaient chaque année le ferry pour traverser l’East River.
L’architecte, John Augustus Roebling — qui fit aussi celui au-dessus des chutes du Niagara — se chargea des plans et c’est son fils qui le réalisa, s’inspirant des nouvelles techniques européennes. Le résultat est un véritable chef-d’oeuvre d’es- thétisme et d’Ingenierie.
Jouer les parfaites touristes avec brochure en mains me fait soudain grimacer, me sentant un tantinet ridicule. Il ne me manque plus que l’appareil photo !
Une brutale pensée me ramènent vers Jacques — dans quel pays du monde se trouve-t-il maintenant, de quel ouvrage est-il en train de s’occuper, un pont comme celui-ci, un bar- rage... ? Même si je n’ose l’admettre, il ne s’est pas évaporé de ma mémoire, son image est récurrente.
28
Je me ressaisis et m’intéresse de nouveau au pont, doté d’une allée piétonnière se situant au-dessus des voitures et passant sous les arches néogothiques en granit. Elle longe d’énormes réseaux de câbles. Au centre, sous la double voute principale, nous nous arrêtons un instant, nous accoudant à la rambarde. La vue sur Manhattan et le port est splendide.
Je réalise à ce moment que, contrairement à ce dont je me moquais il y a quelques minutes, j’aurais bien aimé avoir un appareil photo ! J’exprime mes regrets en m’invectivant à haute voix.
Mais c’était sans compter sans Karl-Heinz qui extrait de son sac à dos un superbe Kodak qu’il me tend en s’excusant de ne pas y avoir pensé plus tôt. Il précise qu’il l’a chargé d’un film pour diapositives, ce qui me va très bien.
Je profite de notre pause pour mitrailler dans tous les sens, sans oublier bien sûr de fixer pour l’éternité mes deux com- pagnons, qui se tiennent malgré tout en permanence à dis- tance respectueuse. Assez curieux, il faudra que j’élucide un jour cette froideur qui semble persister entre eux. Mais ce sera pour un autre jour. Je saurai bien plus tard, de la bouche de Noémie, quand nos chemins se sépareront, que celle-ci lui avait fait quelques avances tout au début, repoussées avec la froideur qui caractérise notre homme.
Nous reprenons notre marche, quittons le Brooklyn Bridge par un souterrain assez délabré qui contraste avec la magnifi- cence de l’ouvrage. Puis nous arrivons dans un joli jardin de style japonais avec petit pont et ruisseau que borde un restau- rant sur l’East River.
Nous avons encore une heure devant nous pour retrouver Jerry, et nous en profitons pour longer le fleuve. Quelques nappes de brume bleutée flottent au ras des berges. Malgré le froid, de nombreux joggeurs circulent dans les parcs. Je n’ai
29
jamais remarqué autant de coureurs à pied qu’à New York, qui semble être le sport principal des gens d’ici.
En nous éloignant du pont de Brooklyn, nous découvrons au loin, de l’autre côté du port et au centre de la baie, la statue de la Liberté, minuscule vue de là. Nous nous promettons de nous y rendre par ferry très bientôt.
Contrairement à ce que nous craignons, la neige ne s’est pas mise à tomber. La grisaille du ciel semble moins épaisse, plus transparente. Curieusement, un parfum de marée et d’algue flotte dans l’air. Puis nous revenons sur nos pas, et allons prendre un café dans l’établissement que nous avons remar- qué en arrivant.
Mais il est temps de rejoindre notre ami. Nous levant presque à regret, la vue de la terrasse chauffée est splendide et l’am- biance chaleureuse, nous parvenons au point de rendez-vous. Jerry, adossé à la carrosserie, nous attendait les mains dans les poches, mâchouillant son éternel chewing-gum.
Nous repartons, notre guide ayant l’intention de nous conduire au parc d’attractions de Coney Island, regrettant toutefois que ce ne soit pas la meilleure saison pour le faire. Il paraît qu’en été, la balade vaut le détour.
Nous mettons donc le cap sur l’extrémité de Brooklyn. Je suis assez curieuse de découvrir un lieu de loisirs à l’améri- caine, n’ayant jusqu’à présent que profité de la Foire du Trône de Paris et celle de Vienne dans le Prater.
Des maisons basses remplacent soudain les gratte-ciel. Les faubourgs que nous traversons maintenant, très certaine- ment voués à la démolition, reflètent une pauvreté telle que j’ai honte d’en être témoin. Taudis et ghettos que seul le feu pourrait faire oublier. Nous passons rapidement. Après avoir longé un cimetière gigantesque, nous arrivons dans un autre quartier, nettement plus élégant et agréable.
30
Des rangées de pavillons aux murs de bardeaux blancs et aux toits de tuiles rouges, mitoyens, devancés d’un jardinet et toutes munis d’un même escalier ressemblent à ceux de la banlieue de Londres et s’étendent soudain à perte de vue. Quelques petits centres commerciaux en rompent la monoto- nie. Je suppose que c’est la classe moyenne qui vit ici, ayant pu remarquer les prix quelque peu prohibitifs des loyers du coeur de Manhattan qui, à mon avis, doivent provoquer l’évasion de la population vers Brooklyn que nous traversons, la plus peuplée des boroughs, me précise Karl-Heinz, mais aussi le Queens, un peu plus au nord, Staten Island, le Bronx... New York est certainement la ville la plus pluriethnique qu’il m’ait été donné de visiter à ce jour.
Après une heure de route, nous apercevons à l’horizon une grande roue en activité. Quelques instants plus tard, nous nous arrêtons devant le parc de Coney Island, en pleine effer- vescence. Puis, quelques pas plus loin, nous arrivons sur une immense esplanade qui longe la plage, bordée de baraques de restauration. L’océan est là, de toute part, et au loin, perdu dans la brume, le New Jersey que l’on devine à peine.
Dans ce lieu s’évanouissent les parallèles, disparaissent les cubes monstrueux qui s’empilent les uns sur les autres, s’ef- facent les épées de verre qui se croisent dans le ciel. La vie semble reprendre un cours normal, à la mesure de l’homme.
Une mouette plane au-dessus de nous et lance un appel strident. Des paquets de mer passent par-dessus la jetée. L’At- lantique, pourtant houleux et sombre, ressemble à lui-même ici comme ailleurs. Je le regarde inlassablement, et oublie que la France est à l’opposé, à des milliers de kilomètres.
Je me revois avec ma mère pendant nos dernières vacances, sur une plage de Vendée. Je scrutais alors l’océan vers l’Amé- rique, loin d’imaginer que quelques années plus tard, comme
31
dans un miroir qui renvoie l’image, je contemplerais, à travers son interminable solitude, la France.
Karl-Heinz, Noémie et Jerry sont partis, me précisant qu’ils allaient faire un tour dans le parc d’attractions, me laissant à ma rêverie.
Hivernal, le vent du large fouette avec rage un mat surmonté du drapeau américain, sous lequel j’arrête mes pas. Je rabats la capuche de mon anorak et m’entoure frileusement de mon écharpe.
L’océan, de plus en plus houleux et crêté d’écume, fait tan- guer les ferrys qui sillonnent la baie et gronde dans le lointain.
Quelques flocons turbulents tournoient dans les airs.
À mi-chemin entre le passé et le présent, pas tout à fait morts ni entièrement vivaces, mes souvenirs comme la neige, cinglent et m’enveloppent de leurs manteaux glacés.
Les mains dans les poches, je suis incapable de dire combien de temps je reste là. Soudain, on me prend doucement par le bras. Émergeant de mes pensées, je frissonne, complètement transie. Le vent frisquet du large apporte le mugissement sourd d’une corne de bateau. Mon regard se perd vers l’horizon à sa recherche, ne distingue plus rien d’autre que les flocons serrés qui vibrionnent maintenant dans l’air gris.
— Venez, Mademoiselle. Vous allez prendre froid. Karl-Heinz m’entraîne vers la Cadillac, avec fermeté.
Il reprend place à côté de notre chauffeur, tandis que je me blottis à l’arrière de la voiture aux côtés de Noémie, aux joues rougies par la brise. Répondant machinalement à sa descrip- tion des manèges qu’ils ont expérimentés, je m’enfonce dans une douce torpeur, provoquée par le ronronnement discret et feutré du moteur. Engourdie, je m’abandonne aux souve- nirs, qui, aujourd’hui plus que d’habitude, surgissent dans ma mémoire.
32
Jacques...
Que de longues années depuis notre séparation, un 10 jan- vier glacial comme ce jour, à l’aéroport d’Orly ! Sept ans déjà, jour pour jour ! Je revois sa haute stature disparaissant dans la carlingue du Boeing qui me l’arrachait pour toujours. Je l’ai laissé s’envoler, sans rien tenter d’autre que d’essayer de gommer de mon esprit la moindre parcelle de son existence. Devant l’alternative de rester avec ma mère et de partir avec lui, j’ai choisi. Je n’ai rien à regretter. Mais la blessure saigne encore, malgré les années écoulées. Je garde en moi l’image de lui, éclatant du bonheur que nous avons partagé.
Notre guide à l’intention de ne rien nous épargner quant à notre visite de la ville. Nous venons de longer Kennedy Air- port, et traversons le quartier des Queens, banlieue aussi triste que plate où n’apparaissent que des murs lépreux, des toitures en tôle ondulée, des papiers sales sur les trottoirs.
Même Karl-Heinz paraît avoir perdu sa vitalité. Seul, le Shea Stadium, haut lieu du base-ball, semble allumer quelques étin- celles dans son regard terne qu’il tourne vers moi, guettant mon avis.
Sa voix me parvient, nasillarde, dans l’interphone prévu entre la cage du conducteur et la partie réservée aux passagers du taxi.
— Où désirez-vous aller maintenant, Mademoiselle ?
Nous roulons depuis un bon moment. La neige a cessé de tomber et une nappe immaculée recouvre le champ de courses que nous contournons. J’ai compris que nous étions en train de traverser le Bronx.
Je commence à être lasse. Le peu d’intérêt que je porte à notre balade depuis mon idée farfelue d’aller dans ce quartier lugubre et la monotonie des immeubles en brique rouge flan- qués d’escaliers en zig-zag et de toits surmontés de réservoirs
33
d’eau, me plongent à nouveau dans le passé, en Auvergne, dans la petite maison de la Sente du Diable, avec Jacques.
Les heures chaudes s’étiraient dans la solitude de la forêt profonde, où seul le chant des oiseaux entrecoupait le silence. Qu’il est loin le temps où la clairière résonnait de nos rires d’amants heureux !
Unique lien avec cette période, Picpus ramené de là-bas té- moigne de la réalité de ces instants. Devenu matou somnolent et despote à ses heures, il est de tous mes voyages, insensible aux choses du monde extérieur. Je l’imagine en ce moment, en boule au pied de mon lit, contemplatif et patient, attendant mon retour. Lui aussi a perdu son amie, éteinte de vieillesse, Zouzou, la minette que nous possédions depuis mes quinze ans, ma mère et moi. Elle a rejoint le paradis des chats tranquil- lement, après un long câlin sur les genoux de Thérèse, et s’est endormie doucement sans ne plus jamais se réveiller. Cette mort a beaucoup contrarié Maman, ignorant que la sienne allait intervenir quelques semaines plus tard, le Vendredi saint de l’année 1968. Des dates qui marquent à tout jamais.
En plein deuil, j’ai d’ailleurs totalement zappé les évène- ments de mai à Paris, et n’ai rien compris aux revendications de l’époque. Je crois que j’ai repris le contact avec la réalité politique du pays au décès du général de Gaulle, en novembre 1970. Mais, entre les deux, c’est un néant de brume grise qui stagne dans mon esprit.
Je m’aperçois soudain que nous sommes revenus dans Man- hattan et surtout dans un quartier plus sympathique. Nous sommes en train de longer Riverside Park, au bord de l’Hud- son. Bientôt, les tours se découpent en dentelle noire sur le fond ardoise qu’est maintenant le ciel. Mais, au coeur de Manhattan, le soir ne parvient pas à s’infiltrer dans les rues. Les lumières clignotent de toute part, tourbillonnent, vrillent, courent sans fin.
34
Arrivant à l’hôtel, Jerry qui ne veut décidément plus nous quitter s’enquiert de nos intentions pour le lendemain. De- vant son sourire éclatant, je n’ai pas le coeur à lui refuser une autre sortie. Nous projetons donc un tour sur Ellis Island – il nous accompagnera jusqu’au ferry — en passant par la statue de la Liberté, puis, si nous en avons le temps, une virée sur Staten Island comme le souhaite Karl-Heinz, et bien sûr les Cloisters. J’aimerais également profiter des dernières heures pour faire quelques emplettes à Times Square et sur la 5e ave- nue. Tout un programme.
La longue route m’a épuisée. C’est avec délice que je m’en- fonce dans l’eau chaude et parfumée du bain que Noémie a préparé à mon intention. Elle a aussi rejoint sa chambre avec joie, mais il est évident que nos promenades l’enchantent.
De la mousse jusqu’au menton, mes souvenirs affluent de nouveau, me montent aux lèvres jusqu’à la nausée.
Trois mornes années ont suivi le départ de Jacques. J’ai repris le chemin de l’école gérée par Mademoiselle Davy où j’en- seignais la musique, refoulant au plus profond de moi mon désespoir.
Seule oasis dans ce désert, ma rencontre avec Hans Maüser. Venu en France pour quelques représentations, je me suis ren- due, un peu par curiosité et beaucoup poussée par la directrice de Sainte-Marie-des-Anges, à l’une de ses soirées. J’en suis revenue éblouie.
Mademoiselle Davy, son amie, a fini par me mettre en rela- tion avec lui malgré mes anciennes réticences. Puis je l’ai revu un certain nombre de fois, tantôt à ses concerts que j’ai suivis assidûment, tantôt chez elle, qui n’a jamais manqué de nous inviter ensemble. La vie reprenait son cours, non pas normal, ceci étant incompatible avec l’absence de Jacques, mais du moins serein, avec un horizon moins bouché.
35
La santé de ma mère, même si elle m’inquiétait toujours, ne semblait pas évoluer dans le mauvais sens. Ses essoufflements, qu’elle tentait de me cacher en vain, me paraissaient moins fréquents, et son teint pâle ne pas trop souvent virer au gris, comme cela lui arrivait avant. Sans avoir l’intention de l’aban- donner, évidemment, je m’autorisais à envisager quelques déplacements pour me produire en tant que soliste. Le disque dont Mademoiselle Davy s’était chargée de l’enregistrement se vendait bien, je commençais à être reconnue dans le milieu des pianistes.
Puis, brutalement, sans que je puisse imaginer un seul instant que les moments qui allaient suivre feraient bifurquer mon destin, ma mère est morte.
Je l’ai laissée un matin, l’embrassant furtivement avec de m’esquiver vers l’école — c’était le dernier jour avant les va- cances de Pâques — sans me douter que c’était l’ultime fois. Quand je suis rentrée à la maison en fin d’après-midi, elle gi- sait à même le sol, déjà froide. Ma mère, ingrate, m’avait quit- tée. Abasourdie, refusant la réalité, j’ai franchi alors le seuil de l’incompréhension. Surtout, l’impression d’être amputée d’un membre m’a terrassée.
Les heures qui ont suivi se sont déroulées dans une brume opaque et floue, douteuses dans leur actualité. Je me revois effectuer les démarches auprès de l’entreprise des Pompes fu- nèbres, envoyer les faire-part. Une giboulée de grêle s’est abat- tue sur nous au moment où ma mère rejoignait sa dernière demeure aux côtés de mon père, dans le cimetière de Saint- Mandé.
Ma tante, effondrée, sanglotait et s’agrippait à mon bras. Des mots qu’elle voulait consolateurs s’échappaient de ses lèvres tordues et inondées de larmes. Je ne comprenais rien de ce qu’elle disait. J’ai attendu Jacques toute la journée. J’avais
36
besoin de lui. Mais comment aurait-il pu être là sans que je l’avertisse ?
Puis soudain, autour de moi, tout s’est obscurci. J’ai sombré dans le néant. Comme des éclairs, quelques bribes de lucidité traversaient la nuit dans laquelle j’avais plongé. Je revois, dans un brouillard, le visage éploré de ma tante penché sur moi, puis m’enfonçais à nouveau dans les ténèbres. Inconscience bénie qui a emporté ma douleur aux confins de l’oubli.
La brusque entrée de Noémie dans la salle d’eau me fait étouffer un cri.
— Êtes-vous souffrante, Mademoiselle ? J’ai frappé plusieurs fois, et comme vous ne répondiez pas, j’ai pensé que vous aviez un malaise.
La voix nasillarde, le regard soucieux, la jeune femme me scrute avec attention tout en me présentant un peignoir de bain, qui, mauvaise coordination, tombe dans la baignoire.
— Non, tout va bien, Noémie. Je ne vous ai pas entendue. Veuillez m’excuser de vous avoir inquiété.
— L’eau est complètement froide. Vous auriez dû sortir de là avant.
Noémie s’affaire autour de moi en maugréant. Elle me tend à nouveau une robe d’intérieur que j’enfile avec célérité.
— Quelle heure est-il donc ?
La jeune femme consulte sa montre, me renseigne.
— Désirez-vous dîner dans votre suite ou préférez-vous re-
joindre Monsieur Karl-Heinz qui vous attend dans la salle de restaurant ?
— Je vais rester seule dans ma chambre ce soir. Qu’il veuille bien me pardonner ! Nous nous verrons demain matin, avant de retrouver notre guide. J’ai quelques instructions à lui don- ner pour notre retour.
37
Noémie prend congé en s’inquiétant à nouveau d’éventuels desiderata de ma part. Tandis que j’attends que l’on me monte le dîner — je sacrifie à la mode américaine en demandant un hamburger et une énorme glace à la vanille en pot de carton —, j’exécute quelques arpèges pour me dégourdir les doigts. Heureusement, les pianos à queue sur lesquels je joue pendant les concerts appartiennent aux salles dans lesquelles nous nous produisons ou sont loués pour l’occasion.
Pour chasser de mon esprit toutes ces réminiscences amères, je déchiffre une sonate qu’un jeune compositeur hongrois m’a envoyée. C’est une musique flexible, délicate et forte à la fois. C’est bien. Très bien même. Je lui écrirai demain pour le ren- contrer.
Picpus, immuable, l’arrière-train bien posé entre les photos de ma mère et de mon père, les oreilles dressées et le nez affleu- rant en haut de la partition, m’observe de ses belles prunelles vertes, la gueule légèrement entr’ouverte, les moustaches fré- missantes. On dirait qu’il me sourit.
Mais le départ approche.
Dès la première heure, l’oeil inquisiteur, Karl-Heinz s’affaire auprès du transporteur qui emporte le piano électrique. La plupart des bagages ont déjà été enlevés pour notre retour le surlendemain. Dûment emballé, enveloppé de couvertures, calé dans une grande caisse en bois, étiqueté de toutes parts, le voici qui disparaît, objet de maintes sollicitudes.
Des ordres fusent, précis, tranchants comme des couperets. Karl-Heinz me présente des documents que je signe sans même y jeter un regard. Noémie vient s’enquérir de ce qu’elle doit préparer pour le vol. Elle emporte les vêtements inutiles pour combler les dernières malles.
Picpus, allongé au pied de mon lit, observe d’un air trouble l’agitation effrénée qui règne aujourd’hui dans la chambre.
38
Je devrais m’en séparer quelques heures demain pendant la durée du vol. Il voyagera dans un compartiment spécial ré- servé aux animaux. Ce qui n’est absolument pas de son goût à en juger par ses miaulements dès que son panier apparaît. Il s’en suit toujours une course pour l’attraper, le chat, par jeu ou par colère, ne prétendant pas se laisser faire. Son instinct en ce moment doit l’avertir du danger, car son regard plus oblique et plus perçant que jamais noircit de contrariété.
Je lui caresse le dos de la main.
— Tour ira bien, sois sans crainte...
On frappe à la porte. C’est Jerry qui se présente à l’heure
prévue.
— OK, nous vous suivons.
Au téléphone, Karl-Heinz hurle encore quelques ordres,
puis, troquant une canadienne contre sa veste d’intérieur, nous rejoint d’un bond dans le couloir.
Jerry, pour notre dernière sortie, nous demande si c’est tou- jours d’accord pour Ellis Island. J’ajoute que je tiens aussi à aller aux Cloisters. Karl-Heinz me fait signe qu’il a une com- munication à faire à ce sujet, il m’en parlera plus tard, il a trop à faire pour l’instant avec les transporteurs. Une visite nocturne, ai-je cru comprendre...
Jerry propose de refaire un grand tour en ville et nous voici repartis à l’aventure, Noémie et moi, Karl-Heinz n’ayant pas le temps de nous accompagner ce matin. Il a neigé cette nuit. Central Park est aussi blanc que le ciel est froid et vide.
Confortablement installée à l’arrière de la berline, le regard errant, l’esprit engourdi, mes pensées flottent dans le vague, mais me ramènent à nouveau vers Jacques.
Jacques...
Après une longue convalescence qui a suivi le décès de ma mère, j’ai tenté une fois de le revoir. J’avais appris par une
39
secrétaire qu’il était de retour en France, après un interminable séjour en Indonésie. Mettant de côté mes scrupules, je me suis rendue à son domicile, à Groslay. La porte s’est ouverte sur une personne âgée, inconnue.
— Que désirez-vous, Mademoiselle ?
— Monsieur Jacques Delcourt, s’il vous plait.
La femme a marmonné, présentant un visage avenant malgré
un air légèrement soupçonneux.
— Il s’agit d’un ancien locataire. Je suis la propriétaire. Je suis
venue m’installer ici quand l’appartement a été libéré. — Connaissez-vous sa nouvelle adresse, par hasard ? — Êtes-vous une parente ?
— Oui, Madame, très proche.
Les traits de la femme se sont éclairés, le sourire s’est fait familier.
— Bien, entrez un instant. Il m’a envoyé une carte de Noël sur laquelle était mentionné son domicile. Je pense l’avoir conservée.
À ce moment précis, j’ai senti la force couler en moi. L’en- tretien que j’ai eu avec l’aimable vieille dame s’est inscrit de façon indélébile dans mon esprit. Je la revois, fouillant dans ses tiroirs, soulevant vases et potiches qui décoraient l’apparte- ment, cherchant derrière les piles d’assiettes du buffet.
— Ah, Mademoiselle. Quelle misère de prendre de l’âge ! On perd la mémoire...
Je pensais :
— Mon Dieu, faites qu’elle retrouve cette carte.
Puis, tout à coup, elle est ressortie de la chambre, tenant
entre ses doigts le bristol.
— La voici. Elle se trouvait en